|
Au-delà du SMSI: l'édification d'une société de
l'information universelle
Entre le "chaînon manquant" et la "fracture numérique": le
rapport Maitland revisité
En 1985, l'UIT publiait un rapport réalisé sur demande spéciale et intitulé Le
Chaînon manquant qui attirait l'attention de la communauté internationale sur le
déséquilibre choquant entre pays développés et pays en développement en ce qui
concernait l'accès aux services téléphoniques.
Ce rapport faisait suite à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT tenue à
Nairobi en 1982 qui avait créé la Commission indépendante pour le développement
mondial des télécommunications. Présidée par Sir Donald Maitland, la Commission
avait reçu pour mandat de déterminer les obstacles au développement de
l'infrastructure des télécommunications et de recommander des solutions pour
stimuler l'expansion des télécommunications dans le monde entier. En 1985, la
Commission a soumis au Secrétaire général de l'UIT d'alors, Richard Butler, un
rapport qui ne laissa personne indifférent, intitulé Le Chaînon manquant.
C'est la Commission Maitland qui a inventé l'expression "le chaînon manquant"
pour souligner l'absence chronique d'infrastructures des télécommunications dans
les pays en développement. Au début de ses travaux, la Commission fut unanime à
constater que "le profond déséquilibre qui ne cessait de croître en ce qui
concerne la répartition des moyens de télécommunication au niveau de la planète
était intolérable".
A cette époque, avant l'ère de la téléphonie mobile, on dénombrait dans le monde
environ 600 millions de téléphones, dont les trois quarts étaient concentrés
dans les neuf pays les plus industrialisés. Le quart restant était inégalement
réparti dans le reste du monde, les pays les plus pauvres d'Afrique
subsaharienne disposant souvent de moins d'une ligne fixe pour 500 personnes.
Le Chaînon manquant a été le premier rapport à insister sur la corrélation
directe entre, d'une part, l'existence d'une infrastructure de télécommunication
et l'accès à cette infrastructure et, d'autre part, la croissance économique
d'un pays. Le fossé se creusait à tous les niveaux de l'accès/du service
universel, montrant non seulement les disparités entre pays riches et pays
pauvres, mais aussi entre les riches et les pauvres à l'intérieur d'un même
pays, entre les ruraux et les citadins.
Devant ce constat, la Commission recommanda que, dès le début du XXIe siècle,
presque chacun puisse avoir accès au téléphone; mais que fallait-il comprendre
par les mots "avoir accès"? Ces termes allaient être définis comme l'existence,
en milieu rural, d'au moins un téléphone à deux heures de marche au plus en l'an
2000.
Pour réaliser cet objectif, de nombreux pays développés se sont attachés à
étendre la couverture de leurs nombreux réseaux aux couches défavorisées de leur
population et à en améliorer les performances. En d'autres termes, l'accent a
été mis sur le service universel (c'est à dire la desserte de chaque habitation
par une ligne téléphonique fixe, en principe), par opposition au concept plus
vaste "d'accès universel".
Pour les pays en développement, Le Chaînon manquant faisait en revanche porter
la priorité sur l'accès universel, c'est-à-dire l'accès aux technologies de
l'information et de la communication (TIC) pour un pourcentage aussi élevé que
possible de la population, en recourant à des stratégies d'accès partagé (par
exemple publiphones, cybercafés, centres communautaires comme les télécentres
polyvalents), plutôt qu'en cherchant à installer un téléphone par foyer.
Vingt ans plus tard, dans quelle mesure sommes-nous parvenus à corriger ce
déséquilibre en ce qui concerne l'accès aux télécommunications. Dans Le Chaînon
manquant, le principal obstacle à l'accès était l'absence d'infrastructure.
Aujourd'hui, le débat s'est étendu aux applications et aux compétences ou à la
formation nécessaires pour permettre aux communautés de tirer parti des
nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Il y a vingt ans, pour créer une infrastructure, il suffisait de charger un
opérateur de réseau téléphonique public commuté (RTPC) de construire ou
d'étendre les réseaux. Les usagers n'avaient besoin quasiment d'aucune formation
pour se servir d'un téléphone. Aujourd'hui, la vie est très différente et les
choses ont beaucoup changé dans la société de l'information, comme en témoigne
l'abandon des réseaux à commutation de circuits au profit des réseaux basés IP,
ou des systèmes fixes au profit des systèmes hertziens sans oublier de
mentionner l'avènement de nouveaux types de réseaux d'information comme
l'Internet.
Le retard se comble, mais pas assez vite
L'UIT prend régulièrement la mesure des efforts faits
pour réduire la fracture numérique, en particulier par le biais du rapport sur
le Développement des télécommunications mondiales, dont la première édition a
été publiée à l'occasion du 10ème anniversaire de la publication du Chaînon
manquant. Voyons quels progrès ont été réalisés au cours des 20 dernières
années:
- En 1985, près de trois milliards d'êtres humains,
soit environ la moitié de la population mondiale, vivaient dans des pays
dont la télédensité (nombre de lignes téléphoniques pour 100 habitants)
était inférieure à 1, alors que la télédensité moyenne à l'échelle de la
planète tournait autour de 7. On dénombrait moins d'un million de téléphones
mobiles et on ne comptait que quelques dizaines de milliers d'utilisateurs
de "l'Internet" (le World Wide Web, la Toile, n'existait pas encore).
- Fin 2005, huit pays seulement (représentant moins
de 160 millions habitants, soit environ 2,5% de la population mondiale) ont
une télédensité totale (fixe plus mobile) inférieure à 1. La moyenne à
l'échelle de la planète avoisine 50 et on compte environ deux milliards de
téléphones mobiles et quelque 750 millions d'utilisateurs de l'Internet dans
le monde entier.
Si les progrès réalisés sont énormes, il reste
néanmoins de grandes différences en ce qui concerne l'accès aux
télécommunications: par exemple, en 2003, la télédensité totale oscillait entre
0,3 au Libéria et 173 à Taïwan (Chine).
En Chine, la télédensité fixe, qui n'était que de 0,3%
en 1985, atteignait 20,9% en 2003, taux auquel il faut ajouter les 21,5% de
télédensité mobile. En Inde également, la télédensité fixe a considérablement
augmenté, passant de 0,4% en 1990 à 4,6% en 2003, la télédensité mobile
atteignant de son côté 2,5%.
Certains des taux de croissance les plus élevés ont été observés en Afrique, où
l'économie régionale des télécommunications croît aujourd'hui le plus
rapidement. A l'époque du rapport Maitland, le continent ne comptait que 7,1
millions de téléphones. Comme indiqué dans un célèbre passage du rapport, en
1985, Tokyo avait plus de téléphones que toute l'Afrique réunie, soit à l'époque
un demi milliard de personnes. Pourtant, en 2003, le nombre de téléphones fixes
en Afrique avait triplé et le nombre de téléphones mobiles avait dépassé la
barre des 50 millions. Au cours des premières années du début du XXIe siècle, le
nombre d'utilisateurs du réseau en Afrique a augmenté plus que pendant tout le
XXe siècle.
La baisse des coûts d'implantation des réseaux mobiles et la libéralisation du
marché des télécommunications ont beaucoup contribué à améliorer l'accès aux
télécommunications, en particulier dans les communautés rurales et excentrées.
Par ailleurs, les deux principales lignes d'évolution qui ont caractérisé le
paysage des TIC ces vingt dernières années, à savoir la croissance des
télécommunications mobiles et l'Internet, n'avaient pas été prévues dans le
rapport Maitland.
L'énigme de la fracture numérique
Les TIC étant aujourd'hui l'épine dorsale de l'économie
mondiale de l'information, "le chaînon manquant" du rapport Maitland a cessé
d'illustrer des disparités au niveau des services vocaux à bande étroite pour
désigner une nouvelle réalité, dénommée la "fracture numérique". C'est en 1998
aux Etats-Unis, à l'occasion de la publication par la National
Telecommunications and Information Administration de son rapport Falling through
the Net II: New Data on the Digital Divide, qu'il a été pour la première fois
question de "fracture numérique", expression utilisée pour rendre compte de la
répartition inégale des TIC entre les différents groupes socio-économiques aux
Etats Unis, illustrant de grands écarts dans plusieurs domaines: présence du
téléphone, de l'ordinateur et de l'Internet par foyer en termes de revenus,
d'âge, de lieu et de niveau d'enseignement.
Fracture entre pays développés et pays en développement
L'écart entre pays développés et pays en développement
est illustré par le taux de pénétration des différents services TIC (téléphone,
téléphone mobile et Internet) et des ordinateurs individuels. Comme il ressort
du graphique ci-dessous, cet écart s'est nettement réduit par suite de la
croissance vertigineuse des technologies mobiles et de l'immense popularité de
l'Internet dans le monde entier. Toutefois, comme les pays en développement
représentent plus de 80% de la population mondiale, il leur reste encore
beaucoup de chemin à parcourir.
Imaginons que les populations des pays croissent à un rythme identique et que,
par ailleurs, le taux de croissance des TIC d'aujourd'hui se maintienne; si tel
était le cas, selon le rapport de l'UIT, The Portable Internet, publié en
septembre 2004, il faudrait au moins dix années pour combler l'écart. Or, en
réalité, la population des pays en développement croît plus rapidement que celle
des pays développés et les moins de 15 ans y sont proportionnellement beaucoup
plus nombreux.
|
Fracture entre pays développés et
pays en développement |
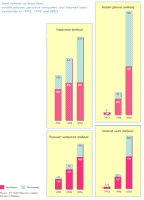 |
Nombre total de
lignes fixes, de téléphones mobiles, d'ordinateurs individuels et
d'internautes dans le monde en 1993, 1998 et 2003.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Pour une version haute résolution, cliquez
ici
 |
Pour reprendre les termes mêmes du rapport, "Il s'ensuit qu'il faudra peut-être
beaucoup plus de temps pour réduire la fracture numérique. Par ailleurs, étant
donné que plus d'un milliard d'habitants de pays en développement vivent avec
moins de deux USD par jour, c'est-à-dire bien en dessous du niveau de revenu
minimum généralement accepté nécessaire pour pouvoir disposer de TIC et les
utiliser, il est très vraisemblable que le caractère fondamental de cette
fracture perdurera, sauf profond changement des conditions socio économiques de
base".
Autres fractures ... autres enjeux
Il existe certaines similitudes entre le chaînon
manquant de la Commission Maitland et la fracture numérique d'aujourd'hui; la
plus importante c'est que, dans l'un et l'autre cas, il existe une relation
directe entre l'accès aux télécommunications, la richesse économique et le
développement social. La fracture numérique existe non seulement entre pays
développés et pays en développement, mais également à l'intérieur de chaque
pays, entre villes et campagnes, entre riches et pauvres, entre diplômés et non
diplômés, entre hommes et femmes, entre jeunes et moins jeunes... jusques et y
compris dans les zones rurales et défavorisées où existe, même dans des pays en
général bien développés, une fracture numérique qui laisse à ceux qui sont déjà
défavorisés encore moins de chances de rattraper leur retard. Dans un souci de
précision, il faut garder présent à l'esprit que la "fracture numérique"
recouvre des situations fort différentes.
Dans son projet de document sur les problèmes de développement liés à
l'Internet, le Groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet (GTGI) insiste
sur le fait que "la notion de fracture numérique ne se limite pas de fait aux
disparités dans le domaine de la téléphonie et de l'équipement, mais s'applique
également aux différences au niveau du contenu, de la langue, des applications
et de la capacité à utiliser efficacement ces technologies pour accéder et
contribuer à toute la gamme des services d'information et de communication qui
deviennent viables au fur et à mesure que la convergence des technologies
s'accroît et que le coût de leur fourniture baisse".
Le GTGI relève que "toutefois, on s'interroge encore sur les diverses
composantes et sur les dimensions de la fracture, certains mettant en premier la
fracture téléphonique, problème qu'ils considèrent comme plus facile à
résoudre". Et de poursuivre en mentionnant cette suggestion qui a été faite:
"L'extension de la téléphonie mobile est la solution pour réduire la fracture
numérique, l'accès à l'Internet via les télécentres revêtant moins d'importance
en tant qu'outil de développement pour des populations pauvres, souvent
illettrées qui sont dans l'incapacité d'en profiter véritablement". A cet égard,
le GTGI conclut: "On ne voit pas encore très bien dans quelle mesure la notion
d'accès universel et les instruments de sa mise en oeuvre ont pris en
considération la convergence des technologies, au point que l'accès universel
recouvre non seulement l'accès à la téléphonie vocale de base, mais également
l'accès à l'Internet".
Connecter le monde
A l'heure où les pays développés ne parlent que de transmission de données, de
services multimédias ou d'Internet, les pays en développement ne
risqueraient-ils pas de voir s'accroître leur retard s'ils faisaient porter
leurs efforts uniquement sur la téléphonie mobile? L'accès universel aux TIC
est-il un luxe que ces pays ne devraient pas encore considérer comme une
priorité? Le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), dont la
première phase s'est tenue en décembre 2003, a indiqué la voie à suivre en
constatant dans son Plan d'action que l'infrastructure des TIC est essentielle à
la réalisation de l'objectif de l'inclusion numérique; un des objectifs du SMSI
est en effet de connecter tous les villages aux TIC d'ici à 2015. L'UIT a déjà
relevé ce défi en créant, en juin 2005, l'initiative multipartenaire "Connecter
le monde".
La fracture numérique reflète habituellement les disparités de revenus, de santé
et d'éducation constatées entre les pays, mais également à l'intérieur des pays,
la cause première étant la pauvreté. Personne ou presque ne renonce
volontairement à se nourrir, à se loger, à se soigner, mais quand ces besoins
fondamentaux ne sont même pas satisfaits, on a rarement envie de s'intéresser à
des technologies comme les TIC. Créer des infrastructures, faire baisser le coût
des services sont des mesures qui peuvent permettre d'accroître l'accès aux TIC,
mais sont-elles la garantie que les populations vont véritablement utiliser ces
technologies?
Le SMSI: un moteur du développement
L'édition 2002 du Rapport sur le Développement des
télécommunications dans le monde de l'UIT, dont le sous-titre était "Réinventer
les télécommunications", a fait ressortir deux obstacles: le premier est la
formation, les technologies d'aujourd'hui étant beaucoup plus complexes à
utiliser qu'un simple téléphone d'hier (l'Internet présente peu d'intérêt pour
quiconque ne sait pas tirer parti de l'accès électronique à l'information pour
améliorer ses conditions de vie); le second est l'absence totale de motivation
pour utiliser l'Internet. S'il y a de nombreux exemples de réussite qui montrent
comment l'utilisation des TIC peut servir à améliorer la vie quotidienne, même
au coeur des communautés les plus isolées, on ne fait pas assez de recherches
pour démontrer comment les TIC peuvent véritablement transformer le processus du
développement dans les pays pauvres.
La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de décideurs prennent conscience
(notamment grâce au processus du SMSI) que les obstacles au développement, à
savoir la pauvreté, l'illettrisme, les épidémies et la mauvaise gouvernance, ne
sauraient être surmontés sans un meilleur accès à l'information. En vérité, si
l'information c'est le pouvoir, l'Internet est un puissant outil de
développement pour ceux et celles qui depuis toujours sont laissés pour compte.
Paradoxalement, le principal moyen utilisé dans nombre de pays en développement
pour accéder à l'Internet est la connexion téléphonique, c'est-à-dire le réseau
public commuté. Etant donné le coût prohibitif et le temps qu'il faut pour
mettre sur pied une infrastructure téléphonique fixe, l'Internet "portable"
(fondé sur l'utilisation de technologies hertziennes évoluées qu'on peut
utiliser avec des réseaux soit fixes, soit mobiles) peut constituer le moyen
pour les utilisateurs et les communautés des pays en développement de faire un
bond technologique en avant et de bénéficier ainsi d'une connectivité améliorée.
Au début, lorsque les décideurs ont commencé à parler de la fracture numérique,
la solution privilégiée consistait à promouvoir l'accès à l'Internet par
connexions téléphoniques interposées, mais aujourd'hui une nouvelle ligne de
fracture est apparue avec le large bande.
Pour qui veut améliorer son accès à l'Internet, la transmission de données large
bande (haut débit permanent) est devenue réellement indispensable. Le jour où la
révolution mobile s'étendra à l'Internet portable et s'accompagnera d'une baisse
des coûts pour les usagers ouvrira des perspectives d'avenir prospère pour les
pays en développement où le mobile est le principal mode d'accès. En effet, même
si les services mobiles de la troisième génération (3G) devaient être appelés à
jouer un rôle dans cette nouvelle donne du large bande mobile, les regards se
tournent déjà vers l'Internet "fixe sans fil" et les technologies à utilisation
efficace de spectre telles que la Wi-Fi, la Wi-MAX et la WIBRO. Si les pays en
développement ne prévoient pas de mettre en oeuvre des politiques d'accès et de
service universels qui soient globales et technologiquement neutres, ils
courront le risque de voir l'histoire se répéter et de faire du large bande le
nouveau "chaînon manquant".
Les usagers des pays en développement ont montré qu'ils sont prêts à payer les
services TIC, à condition que ces derniers soient commercialisés de façon que
tous les utilisateurs puissent se les offrir, par exemple par l'intermédiaire de
cartes à prépaiement. S'il était conçu pour l'Internet portable, un système
analogue de paiement à la carte, couplé avec d'ambitieux programmes d'accès
public, pourrait être la nouvelle solution pour réduire la fracture numérique.
Toutefois, pour que cette éventualité devienne réalité, il faut que
d'importantes questions de normalisation, de même que le problème de l'absence
d'alimentation en électricité fiable, soient d'abord réglées.
L'industrie aura, elle aussi, des défis à relever, en particulier celui de la
simplicité: même les dispositifs mobiles d'aujourd'hui sont encore trop
compliqués pour être utilisés par tous les usagers. L'industrie doit s'attacher
à simplifier l'utilisation de la technologie pour que des personnes réelles, en
situation réelle, puissent en supporter le coût, en comprendre le fonctionnement
et l'utiliser pleinement.
Les versions anglaise, française et espagnole de ce rapport se trouvent sur le
site de l'UIT:
https://www.itu.int/osg/spu/sfo/missinglink/index.html
|



