

Séance 1 Perspectives de la téléphonie IP: aspects techniques
En plus des réseaux classiques à commutation de circuits, on utilise de plus en plus les réseaux basés sur le protocole Internet (IP) pour acheminer le trafic vocal. Marque d'un choix entre technologies concurrentes, c'est aussi le signe d'une tendance à la convergence. Pour comprendre les incidences de la téléphonie IP, il importe d'en saisir les principales caractéristiques techniques. Au cours de cette séance, on examinera les réseaux IP et l'utilisation du protocole Internet dans d'autres réseaux, les questions d'exploitation et de qualité de service, ainsi que les stratégies de développement d'applications et de transition.
Première table ronde Dans la pratique: l'expérience de certains pays
La réglementation de la téléphonie IP varie beaucoup d'un pays à l'autre. Certains régulateurs ont banni son utilisation explicitement ou implicitement, d'autres l'autorisent, voire l'encouragent, mais la majorité d'entre eux n'a pas encore examiné officiellement cette question. Cette séance permettra de définir le cadre d'une table ronde sur les questions de politique générale et servira de forum au cours duquel les pays pourront partager leurs données d'expérience et examiner divers régimes réglementaires.
Séance 2 Questions économiques et dynamique du marché
On examinera au cours de cette séance les principaux problèmes économiques que pose la téléphonie IP. La croissance des réseaux IP dans le monde a de profondes répercussions sur les sociétés, en particulier sur les consommateurs, l'industrie et les administrations nationales, en partie parce que l'infrastructure des télécommunications est de plus en plus perçue comme un élément fondamental de la compétitivité nationale. Grâce à la téléphonie IP, les entreprises et les consommateurs peuvent passer des communications téléphoniques longue distance et internationales à moindre coût et bénéficient de services intégrés évolués. Pour les opérateurs publics de télécommunication (PTO), la téléphonie IP est riche de promesses, mais pose aussi des problèmes. Il est vrai que la téléphonie IP peut aider les administrations nationales à faire progresser leurs objectifs de politique nationale visant à améliorer la qualité, le coût et la gamme des services offerts par les réseaux de télécommunication, mais les PTO historiques disposent de flux de recettes et de technologies qui peuvent être touchés si les consommateurs se tournent vers d'autres services ou d'autres sociétés. Cette séance permettra d'évaluer la situation de la téléphonie IP, les débouchés commerciaux qu'elle crée et son incidence sur les modèles commerciaux.
Deuxième table ronde Questions de politique générale et téléphonie IP
Le Forum a pour but d'aider les Etats Membres à s'adapter à l'évolution de l'environnement des télécommunications induite par l'émergence de la téléphonie IP. Pendant la table ronde, les régulateurs examineront les principales questions de politique générale que pose la téléphonie IP, en particulier les aspects économiques et réglementaires. Ce faisant, les animateurs examineront le rôle que les pouvoirs publics sont appelés à jouer pour répondre aux intérêts des consommateurs et encourager l'investissement dans l'infrastructure pendant la période de transition, aussi bien pour les services que pour les réseaux. Parmi les questions examinées, on peut citer le statut de la téléphonie IP dans le cadre existant ou le cadre nouvellement créé, les problèmes que cette téléphonie pose pour le service universel, l'incidence économique sur les PTO (en particulier dans les pays en développement), les problèmes transfrontières, la convergence et le développement des ressources humaines. Cette table ronde réunira des régulateurs de pays qui en sont à des stades différents de libéralisation du marché.
L'utilisation croissante des réseaux fondés sur le protocole Internet (IP) pour les services de communication, y compris pour les applications telles que la téléphonie, est devenue une question cruciale pour l'industrie des télécommunications dans le monde entier. La possibilité d'acheminer du trafic vocal sur des réseaux IP, avec tous les problèmes qui en sont les corollaires, mais aussi les débouchés qu'elle offre, notamment au niveau de l'intégration voix/données, devra être marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de la convergence du secteur des communications. Elle est également le reflet de la convergence entre deux technologies qui ont vu le jour dans des contextes politiques et réglementaires très différents:
- le réseau téléphonique public commuté (RTPC)**, fondé sur la technologie de la commutation de circuits et qui, jusqu'à ces dernières années, était fortement réglementé dans la plupart des pays;
- l'Internet, fondé sur la technologie de la commutation par paquets, et qui s'est transformé en réseau de données
est peu, voire pas du tout, réglementé.
|
* Cette série de courts articles sont extraits du rapport que le secrétaire général a présenté au troisième Forum mondial des politiques de télécommunication (Genève, 7-9 mars 2001). **Dans ces articles, l'abréviation RTPC désigne généralement les réseaux téléphoniques à commutation de circuits traditionnels proposés par les opérateurs publics de télécommunication (PTO) ainsi que les réseaux numériques avec intégration des services (RNIS) et les réseaux mobiles terrestres publics (RMTP). |
L'expression «téléphonie IP» peut revêtir une signification différente pour un ingénieur ou pour un décideur et il n'y a pas actuellement de consensus sur une définition exacte. Néanmoins, pour les besoins des délibérations du Forum, il faut différencier les diverses formes que peut revêtir la téléphonie IP. Par conséquent, la téléphonie IP est le terme générique qui désigne les nombreuses possibilités de transmission de signaux vocaux, de télécopie, etc., sur des réseaux IP à commutation par paquets.
La transmission téléphonique sur des réseaux IP peut être subdivisée en deux grandes catégories, à savoir la téléphonie IP et la téléphonie sur Internet, qui se différencient par la nature du réseau IP utilisé: la première nommée utilise des réseaux IP privés coordonnés, tandis que la seconde repose essentiellement sur l'Internet public. La téléphonie IP étant un terme générique, tout au long de cette série d'articles, nous nous sommes efforcés de désigner clairement le type précis de réseaux ou de services décrits et analysés.
Plusieurs des principaux PTO ont annoncé leur intention de faire passer tout leur trafic international par des plates-formes IP et ont consenti de très importants investissements pour mener à bien cette transition. Celle-ci s'explique, entre autres, par le faible coût de la migration du trafic vers des réseaux IP; par exemple, un opérateur estime que cette technologie lui permettra d'acheminer le trafic pour un coût représentant 25% du coût d'un réseau classique à commutation de circuits. La libéralisation des marchés contribue également à favoriser cette migration vers les réseaux IP. A la fin de l'année 2000, plus des trois quarts du trafic international avaient pour origine des pays dans lesquels la téléphonie IP est libéralisée.
Même si les avis divergent concernant la vitesse à laquelle la téléphonie IP se développera au cours des prochaines années, il est généralement admis que tout ira assez vite. Dans le monde, le volume de trafic acheminé par des réseaux IP est déjà de loin supérieur au trafic téléphonique acheminé par le RTPC. Par conséquent, peu de pays peuvent se permettre de ne pas tenir compte de la téléphonie IP. Néanmoins, le RTPC a encore de beaux jours devant lui et les décideurs devront chercher à résoudre le problème de la coexistence et, de plus en plus fréquemment, de la conjugaison des deux technologies de réseau.
Pour les consommateurs, la téléphonie IP peut permettre de réduire fortement le coût des appels téléphoniques longue distance et internationaux par rapport à l'utilisation d'une ligne fixe à commutation de circuits ou d'un réseau mobile. L'économie offerte peut compenser, tout au moins en partie, la perte de qualité qui peut s'ensuivre. Par ailleurs, la téléphonie IP permet d'offrir aux consommateurs des services évolués intégrant la voix et les données, à l'exemple des services de téléphonie intégrée sur le World Wide Web («cliquer pour parler») ou de la messagerie intégrée. Ajouter une capacité de téléphonie au trafic acheminé sur les réseaux IP pose en outre des problèmes relatifs au remplacement des services à commutation de circuits et aux stratégies assurant la transition d'un réseau à l'autre.
Sur le plan réglementaire, la façon de traiter la téléphonie IP varie sensiblement d'un Etat Membre de l'UIT à l'autre, en fonction des intérêts en jeu. Dans certains pays, les pouvoirs publics la définissent de manière à en autoriser la fourniture au public, bien que l'opérateur historique conserve l'exclusivité de la fourniture de la téléphonie de base. Dans d'autres pays, le service est strictement interdit, tandis que dans d'autres encore il fait l'objet de licences et est encouragé.
Etant donné que le trafic de téléphonie IP est essentiellement acheminé hors du RTPC — et donc en dehors des structures réglementaires et financières qui se sont établies autour du RTPC — certains pensent que, pour les PTO historiques des pays en développement, la téléphonie IP pourrait compromettre non seulement les flux de recettes jusque-là assurés, mais encore les programmes élaborés dans le cadre du service universel, qui ont pour objet de développer les réseaux et les services dans les régions non couvertes ou mal desservies. Dans d'autres pays, la téléphonie IP et, en particulier, le déploiement de réseaux IP sont considérés comme permettant d'encourager l'offre de services nouveaux et meilleur marché, et donc de pousser à la baisse le prix de la téléphonie à commutation de circuits.
Aspects techniques et opérationnels des réseaux IPUne évolution radicale se produit sous nos yeux dans l'industrie des télécommunications — évolution sans doute aussi importante que le passage du télégraphe au téléphone ou de l'ordinateur central à l'ordinateur personnel: nous voulons parler du remplacement des réseaux téléphoniques à commutation de circuits traditionnels par des réseaux de données à commutation par paquets, qui reposent sur la technologie IP. Le réseau IP le plus vaste (et le plus connu) dans le monde est «l'Internet», souvent appelé «l'Internet public». Il en existe de nombreuses définitions mais, pour simplifier, on peut dire qu'il s'agit d'un ensemble de réseaux informatiques interconnectés sur le plan mondial qui utilisent le protocole Internet et partagent un même espace d'adresses IP. Les ordinateurs connectés à l'Internet utilisent des logiciels qui font fonction de serveurs ou assurent l'échange d'informations à l'aide d'applications normalisées grand public (par exemple courrier électronique, transfert de fichiers, etc.). L'Internet a connu un succès fulgurant au cours de la dernière décennie grâce à la mise en service de la technologie du World Wide Web qui permet aux utilisateurs d'avoir facilement accès par des hyperliens à des informations du monde entier. Activités de normalisation de la téléphonie IP Bien évidemment, la plupart des téléphones sont encore — et seront encore pendant plusieurs années — connectés aux réseaux téléphoniques traditionnels à commutation de circuits. Les services de téléphonie IP doivent donc pouvoir accepter tout trafic émanant du RTPC et assurer la terminaison d'une communication sur le RTPC, le tout en parfaite continuité. La normalisation technique de la téléphonie IP est en cours dans le cadre de nombreuses entités industrielles et régionales ainsi que d'organismes de normalisation tels que le Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT-T), le Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R), l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) et le Groupe d'étude sur l'ingénierie Internet (IETF). Un exemple de normalisation dans le cadre de l'UIT est la série de Recommandations H.323 rédigées par la Commission d'études 16 de l'UIT-T. Le champ d'application des recommandations de cette série est très vaste: audioconférence, visioconférence multimédia, établissement et commande d'appel, gestion de la largeur de bande, interfaces entre différentes architectures de réseau. Il faut également signaler le Protocole d'initiation de session (SIP) défini par l'IETF pour la conférence, la téléphonie, la détection de présence, la notification d'événements et la messagerie instantanée. Dans certains cas, l'IETF et l'UIT-T ont collaboré directement à la normalisation de la téléphonie IP, c'est ainsi qu'ils ont mis au point le protocole commun H.248 (nom donné par l'UIT-T) ou Megaco (nom donné par l'IETF). Ce protocole définit les relations maître/esclave de gestion des passerelles médias qui assurent l'acheminement de différentes formes de trafic — voix, vidéo, télécopie et données — entre le RTPC et les réseaux IP. Qualité de service et capacité La qualité de service et son corollaire, la capacité de réseau, est un facteur déterminant dans la téléphonie vocale et, à ce titre, occupe souvent le centre du débat sur la téléphonie IP, notamment lorsqu'il s'agit d'établir des classifications réglementaires. La qualité peut se définir sur plusieurs plans: fiabilité, débit, sécurité. Néanmoins, c'est parce que la qualité de transmission de la téléphonie caractérisant actuellement l'Internet public est perçue comme médiocre que la téléphonie sur Internet est rarement considérée comme un service «de qualité exploitant». En règle générale, pour améliorer la qualité, on peut soit mettre en application des critères de qualité de service, soit accroître la capacité disponible. La deuxième solution est sans doute la plus facile à mettre en oeuvre, car elle n'implique aucune action coordonnée des différents fournisseurs de services Internet. |
Numérotage et adressageL'un des problèmes techniques que pose l'intégration de plus en plus poussée des réseaux à commutation de circuits et des réseaux à commutation par paquets a trait à la question de savoir comment établir l'adresse des communications qui passent d'un type de réseau à l'autre. En général, il est jugé souhaitable de disposer d'un plan global intégré d'accès aux abonnés. Par exemple, le même numéro téléphonique UIT-T E.164 permettrait d'atteindre un abonné, indépendamment de la technologie de réseau (IP ou RTPC) utilisée. La Commission d'études 2 de l'UIT-T étudie actuellement un certain nombre d'options envisageables qui permettraient aux utilisateurs de réseaux à adresses IP d'accéder aux utilisateurs de RTPC et inversement. Au titre de l'une de ces options, des ressources de numérotage E.164 ont été attribuées à des systèmes IP. Une autre solution consiste à utiliser le protocole ENUM. Ce protocole établit une architecture et définit un système d'affectation de nom (DNS) permettant de faire correspondre les numéros téléphoniques E.164 à des identificateurs uniformes de ressources (URI — uniform resource identifiers). Les URI sont des chaînes de caractères permettant d'identifier diverses ressources: documents, images, fichiers, bases de données et adresses e-mail. Par exemple, l'adresse http://www.itu.int/infocom/enum/ est l'adresse URI du site Web de l'UIT où l'on trouvera un résumé des activités liées à ce protocole. Au cours de l'année 2000, la Commission d'études 2 et l'IETF ont, après consultation, collaboré à des activités liées à la mise en oeuvre de services ENUM. Etant donné que les numéros E.164 peuvent être synchronisés avec le système DNS, le protocole ENUM aurait d'importantes incidences pour les administrations nationales responsables de la numérotation au titre des «indicatifs de pays». De l'avis de la Commission d'études 2, les instances administratives, y compris les administrateurs de zone DNS, devraient se conformer aux principes applicables spécifiés dans les recommandations pertinentes de l'UIT-T (E.164, E.164.1, E.190 et E.195) concernant l'inclusion des données de ressources E.164 dans l'architecture DNS. Plus précisément, dans une note de liaison récemment adressée à l'IETF, la Commission d'études 2 a indiqué que, la plupart des ressources E.164 étant utilisées sur le plan national, le service ENUM et les décisions administratives sont avant tout des questions nationales qui sont du ressort des Etats Membres de l'UIT. Les responsables nationaux de la réglementation voudront peut-être réfléchir à leur participation aux activités de la Commission d'études 2 relatives au protocole ENUM. Ils pourraient, par exemple, contribuer aux travaux de cette commission en lui soumettant des recommandations qui reconnaissent et/ou protègent les méthodes et les normes en vigueur dans différents pays. Une autre question qui intéresse les administrations est celle de la gestion internationale de la racine de la structure DNS ENUM, dont elles seraient tributaires pour leurs services. |

Les prévisions relatives aux perspectives économiques de la téléphonie IP varient considérablement. D'après les estimations de TeleGeography, en l'an 2000 les réseaux IP ont acheminé quelque 3,7 milliards de minutes de trafic international, soit à peine plus de 3% du total mondial, mais le marché est en pleine expansion. Cette part du total mondial pourrait atteindre, d'ici à 2004, entre 25% (Analysys) et 40% (Tarifica). Selon la plupart des études, la téléphonie IP est aujourd'hui utilisée principalement pour le trafic international plutôt que pour le trafic national longue distance ou local et les Etats-Unis en sont la principale source. Selon les estimations de TeleGeography, les 20 premiers itinéraires de téléphonie IP dans le monde (par volume de trafic) relient les Etats-Unis à d'autres pays, même s'il se peut qu'une partie de ce trafic soit simplement commuté via les Etats-Unis. A long terme, des débouchés commerciaux devraient s'ouvrir à la téléphonie IP pour les réseaux longue distance et les réseaux locaux, surtout si la transition au terme de laquelle les prix devront refléter les coûts n'est pas pour demain.
Le marché de la téléphonie IP, ses produits et ses partenaires, diffère considérablement de celui de la téléphonie RTPC classique, aujourd'hui encore, dominé par les opérateurs nationaux historiques. Bien que la plupart des prestataires de services de téléphonie IP (IPTSP) soient des compagnies des Etats-Unis, ils exercent une activité internationale plutôt que nationale et travaillent souvent en partenariat avec des PTO historiques auxquels ils apportent des compétences et une expérience, en même temps qu'ils leur offrent des possibilités de gain. Le marché peut être segmenté en plusieurs types d'applications: PC à PC, PC à téléphone, téléphone à téléphone et services à valeur ajoutée (selon leur ordre d'apparition).
Le marché peut également être segmenté entre opérations de gros et de détail ou encore entre les IPTSP qui offrent des services payants, et ceux qui offrent des applications gratuites pour l'utilisateur financées par les recettes publicitaires. Il faut également établir une distinction entre les façons dont la téléphonie IP est utilisée pour acheminer des signaux vocaux, par exemple au niveau des réseaux des opérateurs historiques qui basculent vers le protocole IP, au niveau des réseaux des PTO plus récents qui ne sont pas directement connectés aux abonnés, au niveau des réseaux IP qui offrent des services multimédias ou encore via les prestataires de services Internet qui interconnectent l'Internet public au RTPC. La principale source de revenus de ce secteur, pour le moment du moins, est le jeu sur les prix, mais la situation évolue à mesure que les services à valeur ajoutée — messagerie intégrée, gestion de la présence («trouver et suivre l'abonné») et fonctions Web «cliquer pour parler» — représentent une part croissante des recettes.
Aujourd'hui, l'offre de téléphonie IP ne répond pas toujours aux attentes des consommateurs, qui doivent souvent accepter un compromis entre le prix et la qualité. La propension à accepter un tel compromis dépend généralement du facteur prix. Les consommateurs des pays à faible revenu ou, dans les pays développés, ceux des ménages à faible revenu, choisiront plus volontiers la téléphonie IP que d'autres consommateurs pour lesquels le facteur prix est moins déterminant. Les abonnés privés ont souvent plus tendance à recourir à la téléphonie IP que les entreprises, pour lesquelles la qualité de transmission et la fiabilité sont plus importantes.
La nature exacte des avantages des réseaux IP pour les PTO sur le plan des coûts suscite un vaste débat, et peut varier, par exemple:
- Selon qu'un investissement IP concerne un réseau nouveau, modernisé ou qui complète un réseau existant. La téléphonie IP sera plus facilement adoptée dans le cas de réseaux nouveaux ou essentiellement nouveaux. Au Sénégal, où les réseaux existants ne desservent qu'à peine plus d'un pour cent de la population, SONATEL prévoit de convertir son réseau de base en une infrastructure IP d'ici à 2004 et d'offrir aussi bien des services vocaux que des services de données sur le même réseau IP intégré.
- Selon que l'exploitant considéré est un exploitant historique ou nouveau. Les nouveaux exploitants, n'héritant d'aucun réseau à défendre, seront probablement les premiers à adopter la téléphonie IP. Ainsi, en Chine, China Netcom, nouvel opérateur, a entrepris de mettre en place un réseau de téléphonie IP devant desservir 15 villes et comprendre environ 9600 km de câbles à fibres optiques à la fin de l'an 2000. Dans le cas de la Hongrie, les pressions exercées dans un premier temps en faveur de la téléphonie IP émanaient des fournisseurs de services mobiles qui voyaient la possibilité de contourner le monopole du trafic international de MATÁV qui est lui-même aujourd'hui un IPTSP.
- Selon la mesure dans laquelle l'offre comprend des services à valeur ajoutée. Sur des marchés tels que la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong et Singapour où les communications locales sont gratuites (couvertes par la redevance d'accès), les nouveaux opérateurs proposent des services à valeur ajoutée qui permettent aux utilisateurs de la téléphonie vocale de consulter leur courrier électronique (T2mail.com) ou encore assurent des services de boîtes aux lettres vocales et de communication de messages de télécopie (2Bsure.com) sur plate-forme IP.
Pays dans lesquels les prix des communications internationales sont élevés
Le principal avantage de la téléphonie IP sera de faciliter le jeu sur les prix des transmissions vocales simples. Toutefois, dans bon nombre des pays, le trafic téléphonique IP sortant est interdit. Ainsi, la forme principale de téléphonie IP est constituée par le trafic entrant. Même si l'utilisation de la téléphonie IP n'est sans doute pas beaucoup plus légale pour le trafic entrant que pour le trafic sortant, elle est plus difficile à déceler et à bloquer.
Pays où l'on observe une diminution des prix des communications internationales
En ce qui concerne aussi bien les prix de détail (consommation) que les prix de gros (règlements), le trafic de téléphonie IP peut déjà jouer un rôle en stimulant la concurrence sur les prix (en Hongrie ou en Thaïlande) ou en offrant une solution de remplacement aux services proposés par les opérateurs historiques de lignes fixes (en Colombie).
Toutefois, un élément critique est la facilité d'utilisation par les abonnés. Ainsi, au Pérou, le succès de la téléphonie IP est en partie due à la disponibilité d'un équipement comparable à un poste téléphonique (APLIO), capable d'utiliser soit les réseaux IP, soit le RTPC, pour l'établissement des communications (voir l'étude de cas concernant le Pérou, page 21).
Pays où les prix du trafic international sont déjà peu élevés
En raison des effets de la concurrence, la téléphonie IP est appelée à jouer un rôle important pour des raisons autres que le jeu sur les prix. Ses débouchés commerciaux seront vraisemblablement fonction des possibilités d'offre de services intégrés à valeur ajoutée et des réductions de coût que pourraient consentir les PTO. Pour ce qui est des services à valeur ajoutée, au Royaume-Uni, yac.com propose via l'Internet un service de numéros personnalisés et de retransmission automatique des appels. En ce qui concerne les réductions de coût des opérateurs, Concert, coentreprise de BT et d'AT&T, a entrepris de mettre en place un nouveau réseau mondial IP coordonné qui proposera divers services, par exemple de commerce électronique et de centres d'appel mondiaux, et reliera environ 90 villes du monde. Bien que les investissements nécessaires soient de l'ordre de 1 milliard USD par an, l'on considère qu'un réseau IP intégré offre la solution la plus rentable pour le traitement de flux de trafic multiples.
Il est indéniable que les réseaux IP représentent l'avenir de l'industrie des télécommunications. C'est pourquoi investir dans ces réseaux peut être considéré comme un investissement pour l'avenir, quel que soit le niveau de développement économique de tel ou tel Etat Membre. Les arguments commerciaux en faveur de l'investissement dans les réseaux IP sont rarement fondés sur le seul potentiel de la téléphonie IP, mais évoquent plutôt les capacités de ces réseaux à acheminer des données, du texte et de la vidéo ainsi que de la voix. Les futurs réseaux mobiles, tout comme les réseaux fixes, exploiteront vraisemblablement la technologie IP. Ainsi, les Etats Membres qui choisissent d'interdire l'utilisation de cette technologie pour la téléphonie sont peut-être en train d'empêcher les opérateurs nationaux et les nouveaux concurrents d'adopter de nouvelles technologies.

Certains Etats Membres ont choisi d'encourager l'utilisation de l'Internet pour la transmission de texte et de données, mais pas pour la téléphonie. Peut-être leur objectif est-il de mettre les opérateurs historiques à l'abri de la concurrence potentielle. Toutefois, ils encourent le risque que ces opérateurs soient mal préparés à exploiter leurs activités dans le futur contexte mondial. Le PTO de demain aura peut-être des clients «captifs», par l'intermédiaire des services de facturation et d'appui à la clientèle qu'il propose, et pourrait aussi «capturer» le réseau local, contrôlant l'origine et la terminaison des appels. Mais il est peu probable qu'il parvienne jamais à capturer ou contrôler les types d'applications choisis par les clients, la téléphonie IP étant peut-être davantage une application qu'un service.
Traditionnellement, les opérateurs ont recours aux services les plus rentables, c'est-à-dire au service longue distance et au service international, pour subventionner en interne les fonctions d'accès au réseau et les communications locales. Sur des marchés de plus en plus concurrentiels, ce type de subvention interne, donc invisible, n'est plus soutenable. A l'avenir, les opérateurs devront plutôt essayer de résoudre de nouveaux problèmes et, à cette fin, rééquilibrer sensiblement leurs tarifs et compter davantage sur les recettes des communications locales.
Même si la téléphonie IP permet de contourner certains éléments du réseau d'un opérateur, elle ne permet pas de faire l'économie des réseaux locaux. Au reste, dans la mesure où l'on considère que la téléphonie IP est une nouvelle application qui portera un coup fatal aux autres applications et rend l'accès à l'Internet encore plus recherché, il en résultera en fait une augmentation du volume des communications locales et de la demande de lignes supplémentaires. Déjà, dans certains Etats Membres, pas moins d'un tiers des communications locales sont des connexions au réseau Internet et environ 15% du total des lignes locales installées sont utilisées essentiellement pour l'accès Internet. Par ailleurs, l'accès téléphonique à l'Internet se développe très rapidement, tandis que la croissance du trafic international se ralentit. La concurrence rapprochera les prix des coûts et, lorsque la téléphonie IP offrira la solution la moins onéreuse, cette solution aura la préférence du consommateur.
Pour les Membres des Secteurs qui sont des vendeurs d'équipements, l'élaboration de nouvelles lignes de produits IP va vraisemblablement jouer un rôle essentiel dans leur croissance et leur rentabilité futures. Sur les marchés des pays développés, la demande de technologie de réseaux à commutation de circuits a fortement baissé et, bien qu'elle reste soutenue dans les pays en développement, cette tendance ne devrait pas se poursuivre indéfiniment. Les réseaux mobiles de la troisième génération (IMT-2000), qui sont aussi des réseaux IP, offrent aux vendeurs des possibilités supplémentaires de mettre sur le marché de nouveaux produits.
Problèmes de politique et de réglementation posés par la téléphonie IPLa téléphonie IP est traitée différemment d'un Etat Membre de l'UIT à l'autre. Certains l'autorisent ou ne la réglementent pas, d'autres l'interdisent, et d'autres encore lui appliquent diverses restrictions, par le biais de l'octroi de licences ou d'autres méthodes de réglementation. Les tableaux 1, 2 et 3, établis sur la base des réponses à un questionnaire récent de l'UIT sur la réglementation, précisent la position actuelle d'un certain nombre d'Etats Membres de l'UIT en ce qui concerne le statut réglementaire de la téléphonie IP. Toutefois, ces tableaux ne couvrent pas la totalité des Etats Membres, du fait qu'un grand nombre d'Etats Membres de l'UIT n'ont simplement pas adopté de politique spécifique pour ce qui est de la téléphonie IP ou n'ont pas répondu à l'enquête de l'UIT. Les Etats Membres sont invités à fournir des informations complémentaires ou des clarifications concernant leur position, de telle sorte qu'il soit possible d'actualiser les tableaux. Il est aussi à noter que la téléphonie IP est d'actualité alors que de nombreux Etats Membres assouplissent leur réglementation et tendent à se fier davantage au jeu de la concurrence, et non plus à la réglementation sectorielle, pour permettre aux concurrents de lutter à armes égales sur les marchés des télécommunications. Dans ces cadres généraux, l'existence de la téléphonie IP pose aux décideurs et aux responsables de la réglementation des problèmes précis, qui impliquent que soient conciliés soigneusement et en toute connaissance de cause des intérêts divergents, voire concurrents. Quelle est donc la «place», si elle en a une, de la téléphonie IP dans les différents régimes de réglementation des télécommunications? Quels devraient être les droits et les obligations des IPTSP par rapport à ceux des fournisseurs de services téléphoniques traditionnels qui, souvent, sont visés par diverses réglementations relatives aux télécommunications du secteur public et aux obligations de service universel? La téléphonie sur Internet, la téléphonie IP et la téléphonie vocale sur le RTPC doivent-elles être traitées de façon uniforme, ou différemment? Doit-on exiger des IPTSP qu'ils soient détenteurs d'une licence, à l'instar de la plupart des exploitants traditionnels de services téléphoniques vocaux? Ou bien la téléphonie IP doit-elle être considérée comme une technologie nouvelle qui offre de nouveaux services et de nouvelles applications susceptibles de se développer au mieux sans intervention, ou avec une intervention minimale, des pouvoirs publics? Grands objectifsDans un premier temps, il est utile d'indiquer les grands objectifs possibles qui pourraient être fixés par les pouvoirs publics pour la téléphonie IP et sur lesquels pourrait reposer le régime réglementaire adopté. Ces objectifs seraient les suivants: - Service universel/accès universel - Services de télécommunication à un prix abordable - Rééquilibrage tarifaire - Egalité des chances pour les concurrents et les nouveaux venus sur le marché - Encourager les nouvelles technologies et les nouveaux services - Stimuler l'investissement dans le déploiement de réseaux et les nouveaux services - Incidence sur les flux de recettes des opérateurs établis - Transfert de technologie - Développement des ressources humaines - Croissance économique dans son ensemble, en particulier dans le secteur des télécommunications. |
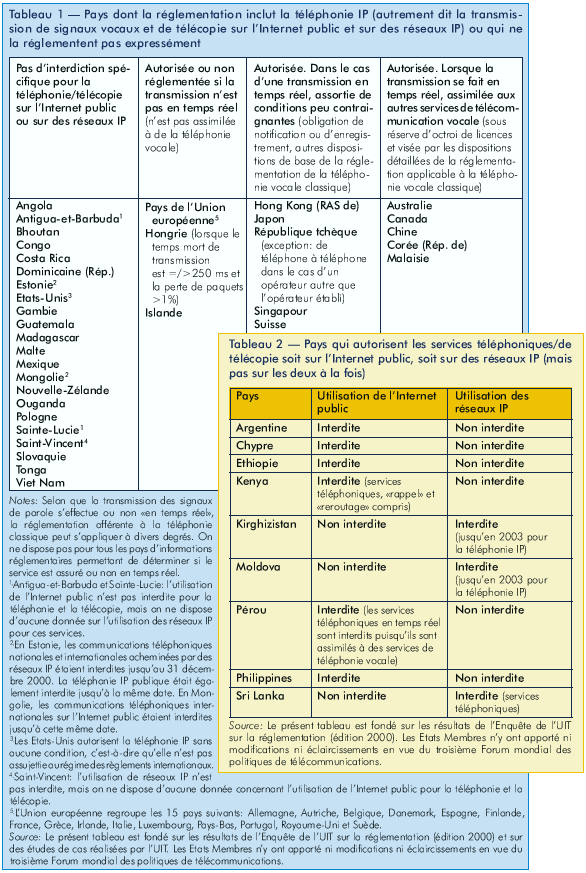
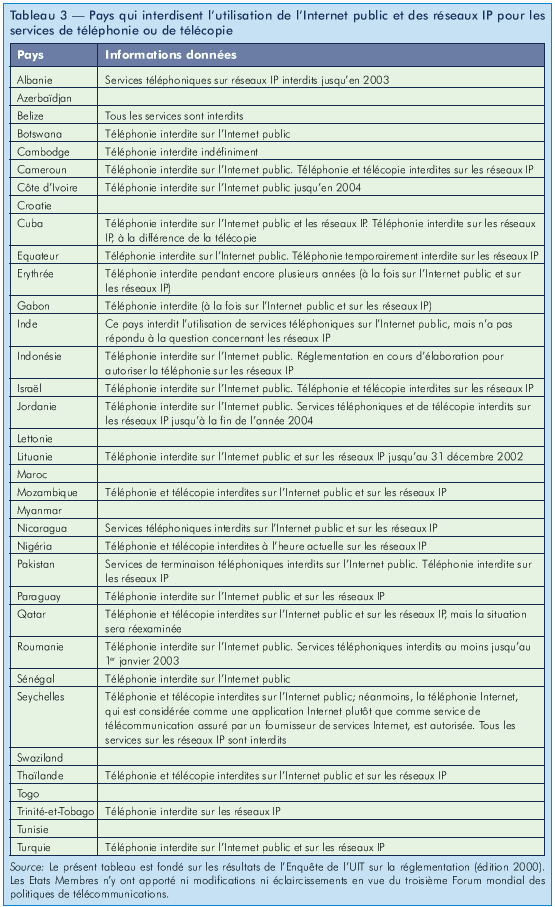
Les analystes spécialistes des questions techniques annoncent depuis plusieurs années que toutes les formes de communications fusionneront tôt ou tard en une plate-forme unique et, depuis quelques années, il semble que cette plate-forme unificatrice soit constituée par le protocole Internet. Avec la pénétration croisée des marchés des opérateurs et des radiodiffuseurs dans de nombreux pays, et alors que les opérateurs de systèmes mobiles adoptent des plates-formes IP dans leurs systèmes de la troisième génération, les structures de réglementation sont appelées à s'adapter dans le monde entier. Parallèlement à la rationalisation et à l'allègement du cadre réglementaire régissant les télécommunications, du fait de la convergence il devient nécessaire de déterminer s'il convient d'appliquer aux nouvelles plates-formes de télécommunication de nouveaux modèles ou s'il faut conserver les modèles existants et s'il est toujours approprié de mettre en oeuvre une réglementation sectorielle.
L'un des principaux problèmes qui se posent sur les marchés des télécommunications récemment ouverts à la concurrence concerne les modalités d'interconnexion des fournisseurs de services locaux. On peut concevoir que certains fournisseurs de services de téléphonie IP cherchent à bénéficier du statut associé à la détention d'une licence d'exploitation locale, qui présente de nombreux avantages en ce qui concerne, par exemple, les droits d'interconnexion, les ressources de numérotage et l'accès à des éléments essentiels tels que les listes d'annuaire. Telle est déjà la situation au Royaume-Uni. La téléphonie IP repose en quelque sorte sur le RTPC, puisque les communications ont parfois pour origine et presque toujours pour point de terminaison le RTPC, mais l'intégration n'est pas totale. La question de savoir si l'intérêt public impose l'interconnexion des différents fournisseurs de services Internet (et fournisseurs de services de téléphonie IP) pourra également se poser dans un avenir proche. Au Chili, les fournisseurs de services de téléphonie IP sont tenus d'assurer cette interconnexion entre eux. Il est à noter que l'Accord de l'OMC sur les télécommunications de base et le document de référence connexe n'imposent l'obligation d'interconnexion qu'aux «fournisseurs principaux».
Une autre solution consiste à appliquer la législation nationale régissant la concurrence, ainsi que les doctrines appropriées élaborées en vertu de cette législation et relatives aux installations essentielles, dans le cadre d'une stratégie favorable à la concurrence visant à assurer l'égalité des chances entre les concurrents.
A de nombreux égards, la concurrence au niveau local semble poser les problèmes de réglementation les plus
complexes entraînés à ce jour par la libéralisation des télécommunications. L'intégration des services Internet,
des services IP et des réseaux à commutation de circuits des opérateurs historiques ou des nouveaux opérateurs
rendra plus complexe l'environnement local. A son tour, le caractère international de l'Internet rendra la coopération
internationale en la matière absolument essentielle.
Aspects transfrontièresL e traitement de la téléphonie IP de téléphone à téléphone peut avoir certaines incidences au niveau du marché de la téléphonie internationale. La téléphonie IP peut servir l'intérêt public dans le pays d'origine en exerçant des pressions à la baisse considérables sur les taxes de règlement internationales et les prix à la consommation. Dans le pays de terminaison, elle peut représenter une solution de remplacement même lorsque les décideurs ont pris le parti de restreindre ou d'interdire la concurrence. Par ailleurs, les IPTSP peuvent bénéficier d'une réglementation plus légère que celle à laquelle sont asservis les opérateurs RTPC historiques. Mais lorsqu'une approche libéralisée dans le pays d'origine est en contradiction avec des politiques restrictives bien définies sur les marchés étrangers où est effectuée la terminaison des services considérés, il peut être utile de disposer d'un moyen de résoudre ce type de problème, tout en respectant les droits souverains des Etats Membres. Les différentes approches du concept de neutralité technologique et de sa mise en oeuvre peuvent amener les investisseurs à douter de l'environnement réglementaire et peuvent empêcher l'expansion mondiale des réseaux IP et de la téléphonie IP. D'une manière plus générale, on pourrait évaluer dans quelle mesure certaines formes de téléphonie IP sont ou devraient être assujetties aux accords et procédures internationaux — plans de numérotage, conventions de routage du trafic, règlements comptables, etc. — qui s'appliquent à la téléphonie internationale traditionnelle. |
Parmi les pays en développement qui ont adopté une politique réglementant précisément la téléphonie IP, nombre d'entre eux ont choisi soit de l'interdire carrément, soit de n'en autoriser la fourniture que par l'intermédiaire du PTO historique. Les pays en développement appliquant un régime de monopole à leurs télécommunications et qui envisagent la téléphonie IP de façon assez libérale sont relativement rares, bien que la Chine soit une exception de taille. Dans ce pays, après une période au cours de laquelle les IPTSP voyaient leurs activités interdites, la téléphonie IP est désormais adoptée par chacun des grands opérateurs internationaux détenteurs d'une licence, qui sont autorisés à fournir des services nationaux et internationaux. En Chine, la téléphonie IP a permis au marché de s'ouvrir plus tôt que prévu à la concurrence, ce qui a entraîné une baisse sensible des prix des communications internationales.
Ceux des pays en développement qui interdisent ou restreignent la téléphonie IP réévalueront peut-être leur position s'ils parviennent à la conclusion que la téléphonie IP permet de faire baisser les prix des communications et de rendre certains services plus accessibles, deux objectifs essentiels de la lutte contre l'élargissement de la fracture numérique. Même si la plupart des Etats en développement se montrent généralement favorables aux réseaux IP, et en particulier à l'Internet, ils sont souvent hostiles à la téléphonie IP.
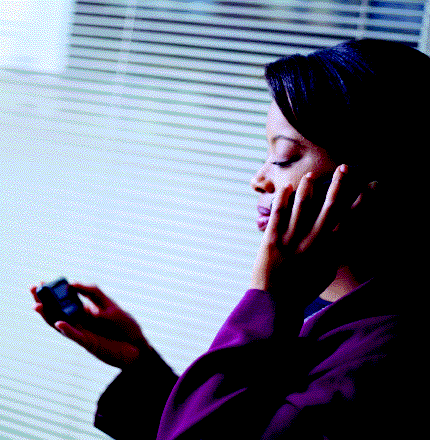
Les fournisseurs de services Internet dans ces pays voient donc leur échapper des recettes potentiellement intéressantes, ce qui peut freiner le développement de l'Internet. Dans certains cas, ces fournisseurs sont priés de bloquer l'accès à certains sites Web qui, depuis l'étranger, permettent d'établir gratuitement des communications IP. Les sites Web étant toujours plus nombreux à intégrer des applications vocales, ces interdictions deviendront de plus en plus difficiles à appliquer. Il se pourrait donc que les fournisseurs de services d'application et les concepteurs de sites Web dans les pays en développement soient en position défavorable pour concurrencer leurs homologues des pays dans lesquels la téléphonie IP est libéralisée.
Au cours des vingt dernières années, les PTO du monde entier ont fait basculer leurs réseaux de l'analogique au numérique. Pour cela, il a fallu que leurs collaborateurs acquièrent de nouvelles compétences. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs de l'UIT ont souvent collaboré pour faciliter les activités de transfert de technologies, de développement des ressources humaines et de maintenance des réseaux au bénéfice des pays en développement.
Le passage des réseaux à commutation de circuits aux réseaux IP représente une mutation aussi radicale que la transition entre l'analogique et le numérique et nécessite, lui aussi, la collaboration des Membres de l'UIT. Du fait que cette mutation coïncide avec le renforcement de la concurrence sur les marchés et qu'il y a souvent pénurie de personnel compétent en matière de réseaux IP, de nombreux PTO des pays en développement craignent de ne pouvoir suivre le mouvement. Comme ils emploient souvent beaucoup de personnel et sont à l'origine de recettes non négligeables pour leurs pays, il est d'autant plus indispensable qu'ils bénéficient d'une assistance dans le domaine du développement des ressources humaines.
Michael Minges et Tim Kelly, analystes en télécommunications à l'UIT

Le présent article décrit la situation de la téléphonie IP dans six pays de différentes régions du monde. La téléphonie IP est un terme générique utilisé pour signifier l'acheminement du trafic de téléphonie, de télécopie et de services connexes, en partie ou en totalité sur des réseaux IP à commutation par paquets. Les six pays ont été étudiés dans le cadre d'un projet d'études de cas consacrées à l'Internet dans différents pays entrepris à l'initiative de l'UIT (voir www.itu.int/ti/casestudies). Ces pays (indiqués dans l'ordre alphabétique anglais) sont les suivants: Bolivie (Amérique du Sud), Egypte (Moyen-Orient), Hongrie (Europe centrale), Népal (Asie du Sud), Singapour (Asie du Sud-Est) et Ouganda (Afrique orientale)*. Leurs situations sont très différentes, tant du point de vue du développement socio-économique que des télécommunications. Ils vont de pays classés parmi les moins avancés (Népal et Ouganda) à faible densité téléphonique, à Singapour, huitième des pays les plus riches du monde (d'après le PIB par habitant) où pratiquement chaque ménage a le téléphone (voir le tableau 1).
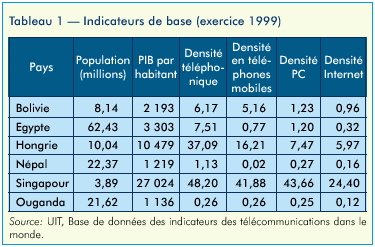
La situation de la téléphonie IP varie d'un pays à l'autre (voir le tableau 2). Dans quatre des pays étudiés (Bolivie, Egypte, Népal et Ouganda), seuls les opérateurs détenteurs d'une licence sont juridiquement autorisés à assurer la téléphonie IP. L'explication est que la téléphonie IP est un service téléphonique vocal pour lequel les opérateurs historiques disposent de licences exclusives. La Hongrie comptait 40 fournisseurs détenteurs de licence à peine six mois après la légalisation de la téléphonie IP. A Singapour, le marché de la téléphonie IP a été ouvert en avril 2000 avec la création d'une nouvelle licence pour la téléphonie et/ou le service de données sur Internet. Toute compagnie peut offrir de la téléphonie IP, sous réserve de détenir une licence et de respecter une qualité de service minimale. A la mi-septembre 2000, 70 compagnies détenaient une telle licence.Les opérateurs historiques et la téléphonie IP
Bien que dans les six pays, les opérateurs historiques soient théoriquement autorisés à fournir des services de téléphonie IP, certains s'abstiennent de le faire, par exemple en Bolivie, au Népal et en Ouganda. Cela s'explique si l'on considère que la principale raison du lancement d'un service de téléphonie IP est qu'il permet d'offrir généralement des prix inférieurs aux tarifs téléphoniques internationaux en vigueur. Ces opérateurs exerçant un monopole, ils ne sont guère poussés à baisser leurs prix.
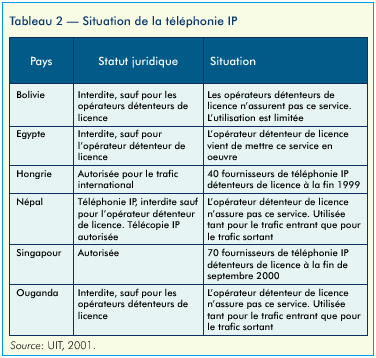
|
* Les six études de cas résumées ici analysent la diffusion de l'Internet dans différents secteurs économiques. Six autres études de cas plus particulièrement consacrées à la téléphonie IP ont également été réalisées en vue du troisième Forum mondial des politiques de télécommunication organisé par l'UIT. Ces études, qui sont consacrées à plusieurs pays (Canada, Chine, Colombie, République de Corée, Pérou et Thaïlande), peuvent être consultées sur le site Web de l'UIT à l'adresse www.itu.int/wtpf. Un résumé en est fourni au chapitre cinq d'ITU Internet Reports: IP Telephony 2001. |
En Egypte, l'opérateur historique a conclu avec des exploitants des Etats-Unis de téléphonie IP un accord pour fournir des services téléphoniques par le biais d'une liaison IP privée directe. Il existe un service de PC à téléphone assuré via le site Web de Telecom Egypt (www.support.idsc.gov.eg) à un tarif équivalent à quelque 20 cents des Etats-Unis la minute. En outre, Telecom Egypt fait aboutir le trafic téléphonique IP entrant à un prix de règlement inférieur à celui des communications sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC).
En Hongrie, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui ont pris l'initiative d'acheminer du trafic téléphonique international sur les réseaux IP. Ils espéraient ainsi contourner le monopole de MATÁV, l'opérateur historique. Plutôt que de subir un manque à gagner du fait de cette perte de trafic, MATÁV a à son tour lancé en décembre 1999 un service de téléphonie IP avec carte à prépaiement (appelée Barangoló). Les utilisateurs peuvent téléphoner dans une quarantaine de pays depuis n'importe quel appareil en Hongrie. Le prix de la communication varie entre 80 HUF (0,28 USD) la minute pour les pays d'Europe et 90 HUF (0,32 USD) pour l'Amérique du Nord. MATÁV joue également le rôle de vendeur en gros de trafic téléphonique IP pour d'autres exploitants, ses concurrents y compris. Alors même que ce service rencontre un grand succès, les utilisateurs font état de plusieurs problèmes (appels mal acheminés ou faux numéros).
Singapore Telecom (SingTel) a lancé deux services de téléphonie IP à des tarifs sensiblement inférieurs à ceux de ses communications internationales habituelles (voir la figure 1). Ainsi, eVoiz permet aux utilisateurs d'appeler depuis leur PC des abonnés dans un certain nombre de pays. Le prix d'une communication d'une minute vers les Etats-Unis est de 9 cents de Singapour (5 cents des Etats-Unis), contre 30 cents de Singapour (22 cents des Etats-Unis) avec l'automatique international. D'après les estimations de SingTel, 10 millions de minutes supplémentaires de trafic international seront imputables chaque année à eVoiz. Le service V019 de SingTel, lancé en août 2000, permet à un utilisateur de téléphoner à l'étranger sur des réseaux IP. Par exemple, un appel d'une minute vers les Etats-Unis coûte 19 cents de Singapour (11 cents des Etats-Unis), soit presque la moitié du tarif habituel de l'automatique international. SingTel reconnaît que la qualité des communications IP est inférieure, mais fait observer dans un communiqué de presse que «même si la qualité des communications avec le service V019 est quelque peu inférieure à celle de notre service 013 BudgetCall, les abonnés cibles la jugent néanmoins acceptable, surtout par rapport au prix».
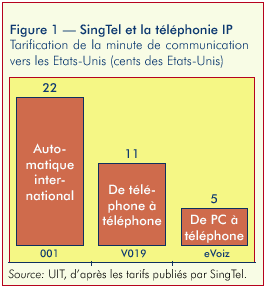
Malgré son interdiction officielle en Bolivie, en Egypte, au Népal et en Ouganda, la téléphonie IP est néanmoins utilisée dans des proportions variables (voir la figure 2). Bien que cette interdiction se traduise habituellement par le blocage du trafic Internet à destination de sites de téléphonie IP très visités (au Népal, le site dialpad.com, d'où il est possible de téléphoner gratuitement aux Etats-Unis, est tout particulièrement interdit), la plus grande partie du trafic de téléphonie IP dans ces pays est probablement constituée par le trafic entrant. En effet, les compagnies de téléphonie IP peuvent conclure des accords avec les fournisseurs de services Internet locaux qui ont leurs propres passerelles Internet internationales, par exemple des paraboles de micro-stations. Ces compagnies aident les fournisseurs de services Internet à acheter des équipements, ce qui leur permet d'acheminer les communications internationales entrant sur l'Internet vers le réseau téléphonique public.
En Bolivie, l'instance de réglementation des télécommunications a été priée à plusieurs reprises de mettre les cybercafés en garde contre l'offre de téléphonie IP. Pourtant, la mauvaise qualité actuelle des communications sur l'Internet dans ce pays décourage la généralisation de cette pratique.
Il semble qu'en Egypte aussi le trafic entrant de téléphonie IP soit supérieur au trafic sortant. Par exemple, bien que la taxe de règlement des communications avec les Etats-Unis sur le RTPC fixée par Telecom Egypt soit de 0,35 USD la minute, des minutes téléphoniques peuvent être achetées à un opérateur au prix de 0,25 USD l'une. Ce rabais tient compte de la taxe de règlement spéciale appliquée par Telecom Egypt pour le trafic téléphonique IP entrant. La même compagnie offre également un service de téléphonie IP de gros pour les appels sortants à destination de la soixantaine de fournisseurs de services Internet du pays, mais sans doute la plupart des fournisseurs de services Internet en Egypte ont-ils conclu leurs propres accords pour le trafic téléphonique IP avec d'autres exploitants.
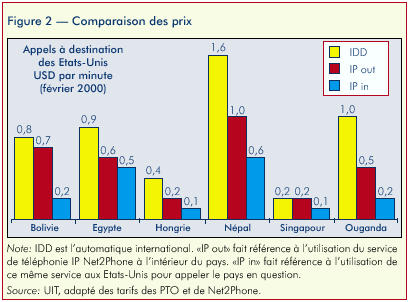
Au Népal, la téléphonie IP est officiellement illégale car elle enfreint le monopole exercé par l'opérateur historique Nepal Telecommunication Corporation (NTC) sur le service téléphonique international. L'instance de réglementation reste neutre en la matière et fait valoir qu'il est pratiquement impossible d'interdire la téléphonie IP. Néanmoins, le ministère des Communications oblige cette instance à signaler aux fournisseurs de services Internet que la téléphonie IP est illégale.
En janvier 2000, l'instance de réglementation a envoyé à tous les fournisseurs de services Internet un avertissement leur demandant de bloquer l'accès à des applications telles que Dialpad. Or, puisque la télécopie IP est autorisée, sous réserve de l'octroi d'une licence, et qu'il est pratiquement impossible d'établir une distinction entre téléphonie IP et télécopie IP, il serait très étonnant que les fournisseurs de services Internet arrivent à appliquer cette interdiction. Au Népal, ils font valoir que l'interdiction de la téléphonie IP est analogue à celle qui frappait autrefois les télécopieurs. Selon le journal The Kathmandu Post du 29 janvier 2000: «Les opérateurs affirment que la NTC réutilise la tactique qu'elle a appliquée il y a quelques années à la télécopie. Rappelons que la NTC avait essayé d'interdire l'utilisation des télécopieurs, craignant une baisse des recettes du télex. Des années plus tard, une bonne partie des recettes des communications internationales [provenait] de l'utilisation de télécopieurs par les abonnés». En janvier 2001, l'instance de réglementation a invité toutes les parties intéressées à se réunir pour discuter d'une nouvelle stratégie à appliquer à la téléphonie IP.
Comme dans d'autres pays, la téléphonie IP est surtout utilisée non pas pour le trafic sortant à partir du Népal, mais plutôt pour les appels internationaux entrants. Bien qu'il soit difficile d'en faire concrètement la preuve, il semble que le trafic téléphonique international entrant passe par l'Internet avant de se répartir localement sur le RTPC. Ce service est relativement facile à fournir depuis la libéralisation des services de données utilisant des microstations et alors que les fournisseurs de services Internet disposent de plus de 5 Mbit/s de capacité internationale Internet. Etant donné que les lignes louées par les fournisseurs de services Internet acheminent vraisemblablement un important volume de trafic entrant, il serait relativement facile de dissimuler le trafic téléphonique entrant (qui vaut une centaine de fois plus cher la minute) en le mélangeant avec du trafic IP entrant de données et de télécopie. Il devient donc difficile de justifier la position officielle sur la téléphonie IP lorsqu'on se rend compte qu'en l'interdisant à la sortie, tout en étant incapable de la bloquer à l'entrée, le Népal se punit deux fois: d'une part, la NTC souffre d'un manque à gagner sur les paiements nets de règlement pour le trafic entrant et, d'autre part, les Népalais sont privés de la possibilité de téléphoner à l'étranger à bas prix.
Comme au Népal, le marché du trafic de données utilisant des microstations est libéralisé en Ouganda. Les perspectives d'autoriser le trafic téléphonique IP entrant sont donc plus favorables dans ce pays que dans les pays limitrophes. Officiellement, seuls les deux opérateurs téléphoniques nationaux détenteurs de licence sont autorisés à offrir la téléphonie IP. Aucun des deux ne prétend le faire; plus encore, ils semblent ne pas être au courant de la possibilité qui leur est donnée. Aucun fournisseur de services Internet en Ouganda n'admet utiliser la téléphonie IP même si, selon certains, il existerait en fait des franchisés travaillant pour le compte de compagnies des Etats-Unis de téléphonie IP actives dans le pays. A la différence de ce qui se passe dans d'autres pays africains, l'instance de réglementation ne s'oppose pas activement à la téléphonie IP.
Il est intéressant de réfléchir aux incidences financières de la téléphonie IP. Celles-ci sont tributaires de plusieurs facteurs dont la dépendance des opérateurs vis-à-vis du trafic téléphonique international — principale cible de la téléphonie IP. Il faut également tenir compte du volume de trafic avec les Etats-Unis, principale source de trafic de téléphonie IP entrant. Un autre facteur est l'écart entre tarifs locaux et tarifs internationaux. En effet, une communication en téléphonie IP ayant toujours pour origine ou terminaison le réseau d'accès local, une taxe d'appel local doit être payée à l'opérateur historique. Si l'écart entre le tarif international et le tarif local est faible, la téléphonie IP ne peut guère être rentable. La qualité du service entre également en ligne de compte. Elle peut varier considérablement pour la téléphonie IP et l'utilisation du service dépendra de la facilité avec laquelle les abonnés peuvent accepter un meilleur prix aux dépens de la qualité. C'est justement là que les pays en développement sont souvent désavantagés du fait de la médiocre qualité du service.
La qualité sonore d'une communication en téléphonie IP peut être aussi bonne que celle d'une communication classique et il est même quelquefois plus facile d'obtenir son correspondant. Par exemple, en Ouganda, seulement 57% des appels internationaux ont abouti en décembre 1999. Certains PTO de pays en développement continuent à interdire les appels sortants sur le RTPC, afin d'augmenter le plus possible les règlements nets. Enfin, l'accès aux équipements d'infocommunication jouera aussi un rôle. Dans des pays comme le Népal et l'Ouganda, où la plupart des ménages n'ont pas l'électricité, encore moins le téléphone, les particuliers ne peuvent pas facilement utiliser des services de téléphonie IP. Un problème connexe se pose: certains pays demandent à l'abonné de déposer une caution avant de lui donner accès à l'automatique international. En Ouganda, moins de mille abonnés au téléphone fixe (sur une soixantaine de mille) peuvent téléphoner directement à l'étranger. Une telle situation peut encourager ceux qui n'ont pas cette possibilité à utiliser la téléphonie IP.
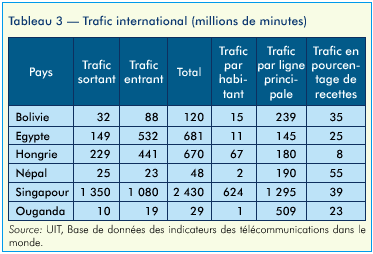
Le tableau 3 indique le volume des appels internationaux et montre que les six pays étudiés sont tributaires du trafic international. Les pays les plus vulnérables semblent être le Népal et Singapour, pour lesquels les recettes internationales représentent une partie importante du total des recettes de télécommunication. Le basculement immédiat de ces pays vers la téléphonie IP pourrait avoir des conséquences d'une ampleur inégalée.
A Singapour, au cours de l'exercice se terminant au 31 mars 2000, SingTel a été à l'origine de 885 millions de minutes de trafic international. Au prix de vente moyen de 1,21 SGD (soit 0,70 USD), ce trafic a rapporté 618 millions USD, soit quelque 22% du chiffre d'affaires de la compagnie. Dans l'hypothèse où la totalité du trafic sortant de Singapour serait tarifé au même prix que la téléphonie IP, SingTel perdrait 521 millions USD, soit une somme supérieure à ses dépenses d'infrastructure pour l'exercice en question. SingTel escompte que la plupart de ses abonnés préféreront la qualité des communications traditionnelles avec commutation de circuits à celle de la téléphonie IP. La compagnie, qui diversifie également ses activités en se lançant dans l'Internet, dispose déjà de l'un des plus grands réseaux centraux Internet au monde. Ce sont les recettes provenant de l'Internet et d'autres réseaux de données qui progressent le plus vite puisqu'elles représentent 16% du chiffre d'affaires total, contre 13% l'année précédente.
Même si l'on s'inquiète des conséquences financières de la téléphonie IP pour les recettes internationales, les distorsions de prix sur d'autres segments de marché deviennent encore plus marquées. Prenons l'exemple du mobile. En Ouganda, les services mobiles rapportent davantage que le service fixe. Les prix sont fixés de telle sorte qu'un habitant de la capitale (Kampala) paie autant pour appeler un abonné au mobile dans sa rue que pour appeler un pays voisin, en l'occurrence le Kenya. Prenons maintenant les communications nationales longue distance. En Bolivie, il est moins cher d'appeler une région frontalière du Pérou que de téléphoner d'un bout à l'autre du pays. Les incidences de la téléphonie IP pour les communications entre poste fixe et mobile ou pour les communications nationales longue distance sont peut-être plus intéressantes à étudier que celles pour la téléphonie internationale.
Le rééquilibrage tarifaire (autrement dit la baisse des tarifs internationaux compensée par la hausse des tarifs locaux) peut minimiser l'importance de la téléphonie IP. Néanmoins, les utilisateurs devront payer davantage pour avoir un accès téléphonique à l'Internet, ce qui risque de les décourager. La proportion de dépenses affectée aux taxes locales fondées sur l'utilisation est importante (voir la figure 3). L'incidence du prix des communications locales est particulièrement frappante en Bolivie. L'une des raisons pour lesquelles les habitants de Santa Cruz se connectent davantage à l'Internet que ceux d'autres régions tient au fait que, contrairement aux autres habitants du pays, ils s'acquittent d'une taxe forfaitaire fondée sur l'utilisation, indépendamment de la durée de la communication. A l'autre extrême, on trouve l'Ouganda où les tarifs téléphoniques à l'utilisation renchérissent singulièrement la facture de l'accès à l'Internet. Les utilisateurs paient presque 100 USD par mois pour 30 heures d'accès téléphonique, quel que soit le moment de la journée. Ils paieraient un tiers de plus s'ils accédaient à l'Internet aux heures de pointe. Il n'est donc pas étonnant que les fournisseurs de services Internet se transforment en opérateurs téléphoniques. Les abonnés qui utilisent beaucoup le téléphone trouvent meilleur marché de se débarrasser de leur téléphone et de leur télécopieur et de s'abonner à des fournisseurs de services Internet qui leur offrent des connexions hertziennes. Ils peuvent ensuite acheminer toutes leurs communications par l'Internet, qu'il s'agisse de courrier électronique, de téléphonie IP ou de télécopie IP.
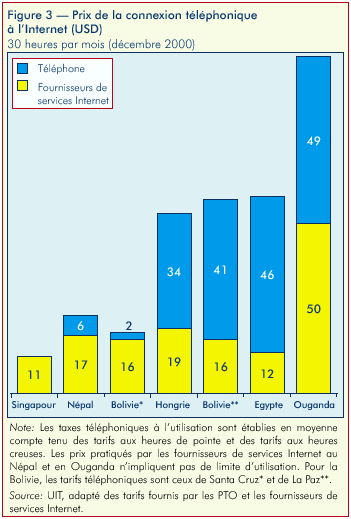
Un autre problème est celui du coût de la largeur de bande pour l'utilisation de l'Internet au plan international. Cela représente une dépense importante pour les fournisseurs de services Internet hors des Etats-Unis car ils doivent supporter la totalité du coût de la connexion, limitant l'utilisation de la téléphonie IP. Par ailleurs, les fournisseurs de services Internet et les compagnies de téléphonie IP aux Etats-Unis ont des connexions gratuites à l'Internet à destination d'autres pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles la téléphonie IP est bien meilleur marché entre les Etats-Unis et d'autres pays. En revanche, la téléphonie IP pourrait profiter de l'expansion de l'Internet. Par exemple, si les compagnies étrangères de téléphonie IP concluent avec des fournisseurs de services Internet de pays en développement des accords prévoyant la mise à disposition de réseaux centraux Internet et de microstations, cela dégagera une plus grande largeur de bande pour le pays, ce qui permettra d'améliorer la qualité de l'accès.
L'interdiction juridique de la téléphonie IP est amenée à disparaître à mesure que les pays libéraliseront
progressivement leurs marchés des télécommunications. En effet, cette interdiction repose presque toujours sur
l'hypothèse que la téléphonie IP est un service vocal qui relève de la compétence exclusive des opérateurs
historiques de téléphonie, plutôt qu'un service ou une application de données.Il devient d'autant plus difficile de
soutenir cette thèse que les fonctions téléphoniques s'intègrent dans d'autres applications Web telles que le
courrier électronique ou les sites «cliquer pour parler». A Singapour, les marchés de télécommunication ont été
entièrement ouverts à la concurrence en avril 2000. Ils le seront en Hongrie à compter de janvier 2002 et en Bolivie
de novembre 2001. Bien que l'Ouganda ne prévoie pas à court terme d'ouvrir à la concurrence la totalité de son marché,
le pays compte néanmoins deux opérateurs privés concurrentiels qui sont encouragés à réduire leurs prix pour
gagner des parts de marché. Il ne reste plus que l'Egypte et le Népal, pays où la téléphonie IP va encore susciter
des controverses pendant quelques années. En Egypte, l'opérateur a opté pour la téléphonie IP mais, au Népal, il
continue à s'efforcer de l'interdire. Comme on peut le constater, chacun de ces six pays a sa propre conception de la téléphonie
IP!
Telecom Egypt: à défaut de battre vos concurrents, faites comme eux!De nombreux liens unissent l'Egypte et les Etats-Unis où plus de 100 000 Egyptiens vivent, travaillent ou étudient. Parallèlement, l'Egypte est, par ordre d'importance, le deuxième pays bénéficiaire de l'aide étrangère des Etats-Unis. Le potentiel de communications téléphoniques internationales entre les deux pays est donc considérable. Alors que le trafic de l'Egypte vers les Etats-Unis n'augmente guère depuis quelques années, le trafic vers l'Egypte a, lui, considérablement progressé, tout au moins jusqu'en 1998, année au cours de laquelle il s'est stabilisé (voir la figure ci-après). En 1998, les exploitants des Etats-Unis ont commencé à acheminer leur trafic via des itinéraires de remplacement, avec à la clé une baisse des paiements de règlement; c'est ainsi qu'ils pratiquent le reroutage via des pays tiers, l'acheminement par l'intermédiaire d'«autocommutateurs privés à l'origine de fuites organisées» et de plus en plus par l'Internet. On estime ainsi à 30 millions le nombre de minutes de trafic en provenance des Etats-Unis ainsi détournées en 1998. Si les exploitants des Etats-Unis détournent le trafic de l'itinéraire direct, c'est que les paiements de règlement dus à l'Egypte n'ont fait qu'augmenter pour atteindre 80 millions USD en 1999 bien que l'Egypte ait réduit le montant de ses taxes de règlement avec les Etats-Unis de 12% en moyenne par an, selon les délais et les taxes de référence fixés par les Etats-Unis. Cela ne suffit ni à satisfaire les exploitants des Etats-Unis ni à compenser les effets, toujours plus marqués, de l'asymétrie du trafic. 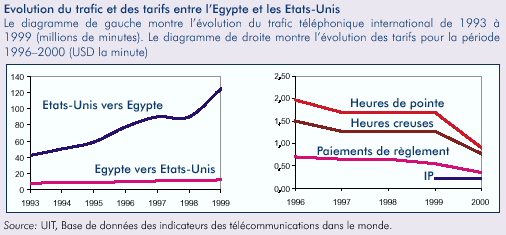
Au début de l'année 2000, Telecom Egypt a convaincu le gouvernement d'interdire le trafic de Net2Phone, compagnie de téléphonie IP ayant été particulièrement active en Egypte. Les utilisateurs ont alors opté pour l'un des quelque 12 autres fournisseurs de services de téléphonie IP. Telecom Egypt a donc conclu qu'à défaut de s'opposer à la téléphonie IP mieux valait suivre l'exemple de ses opérateurs. En mars 2000, la compagnie a donc signé avec eGlobe des Etats-Unis un accord pour la revente de services de téléphonie IP. D'après le communiqué de presse annonçant cet accord, cette initiative aurait reçu l'aval des plus hautes autorités, en particulier du ministre égyptien des Technologies de la communication et de l'information, Ahmed Nazif. Telecom Egypt offre ce nouveau service de téléphonie IP au prix de 80 piastres (21,6 cents des Etats-Unis) la minute pour les appels à destination des Etats-Unis, contre 3,50 EGP (95 cents des Etats-Unis) la minute pour les appels sur le RTPC, d'après les tarifs en vigueur. Afin de promouvoir ce service, Telecom Egypt offre aux fournisseurs de services Internet et aux autres revendeurs un rabais de 10%. Malgré cela, la compagnie signale que la plus grande partie du trafic est du trafic entrant plutôt que du trafic sortant, ce qui laisse à penser qu'elle ne rencontre pas le succès escompté dans la commercialisation de ce service au plan national. Peut-être est-ce parce que le site Web qu'elle a créé pour faire connaître ce service (www.commegypt.net) est régulièrement encombré et n'est accessible que par intermittence. Le tarif fixé par Telecom Egypt pour la téléphonie IP est considérablement inférieur au montant de la taxe de règlement officielle pratiquée avec les Etats-Unis. On ignore ce que rapportent à Telecom Egypt les appels entrants aboutissant sur son service de téléphonie IP. Le principal est néanmoins que ce trafic qui, autrement lui échapperait, rapporte aujourd'hui à Telecom Egypt. |
Le présent article est le dernier de notre série d'études de cas de l'UIT sur la téléphonie IP
Les premiers réseaux privés utilisant le protocole de transmission de la voix par l'Internet (VoIP — Voice over the Internet Protocol) au Pérou ont été mis en place à l'initiative de grandes compagnies privées: organismes bancaires, entreprises ou sociétés d'extraction de ressources naturelles implantés en différents points du pays, par exemple. Les industries minières et pétrolières en sont de bons exemples. La mise en place de réseaux de communication privés a été entreprise principalement en vue de réduire les coûts, la seule autre solution étant d'utiliser les réseaux publics. Toutefois, ceux-ci jouissaient encore d'une situation de monopole jusqu'en 1998.
Aujourd'hui, de nombreuses sociétés telles que Banco Continental, Banco Latino et Banco Interbank
utilisent la technique de la transmission de la voix en mode relais de trame à l'intérieur du pays pour assurer des
services de transmission de signaux vocaux et de données entre leurs bureaux régionaux. Le passage à une plate-forme
IP est réputé être relativement récent, en grande partie du fait qu'à l'époque où la technique de transmission de
la voix en mode relais de trame a été choisie, la technologie IP n'avait pas encore gagné la pleine confiance de ces
sociétés.

|
* Pérou: «La téléphonie IP et l'Internet» fait partie d'une série d'études de cas sur les télécommunications réalisées dans le cadre du Programme des nouvelles initiatives du Secrétariat général de l'Union internationale des télécommunications. La présente étude de cas a été menée par Arturo Briceno (abriceno@spri.com), travaillant chez Strategic Policy Research (www.spri.com), en collaboration avec Juan Carlos Bisso (jbisso@osiptel.gob.pe) et Agustina Guerrero (agustina@baedigital.com.ar), sous la direction de Ben A. Petrazzini, conseiller en matière de politique générale au sein de l'Unité des stratégies et des politiques de l'UIT (Ben.Petrazzini@itu.int). Les textes intégraux de toutes les études de cas de l'UIT sur la téléphonie IP peuvent être consultés sur le Web à l'adresse www.itu.int/iptel. |
La téléphonie IP au Pérou n'en est encore qu'à ses débuts. Il existe de grandes compagnies à même de fournir ce service, à savoir: Telefónica del Perú (TdP), Red Científica Peruana (RCP), BellSouth Perú, SA, FirstCom et Net2Phone, entre autres.
TdP est le principal opérateur de télécommunication et la toute première société en termes de chiffre d'affaires. Les accords de licence qu'elle a passés lui ont conféré l'exclusivité des droits d'exploitation des services de base pendant une période de cinq ans (1994-1999). Toutefois, un accord entre l'Etat et TdP a permis de mettre fin à la période d'exclusivité d'exploitation un an avant la date d'expiration prévue. Par conséquent, le secteur des télécommunications s'est ouvert à la concurrence en 1998 pour ce qui est de l'octroi des licences d'exploitation de services téléphoniques à grande distance et fixes.
TdP a mis en place un réseau IP dans le pays à compter de 1996-1997. En janvier 2000, 28 sociétés au total disposaient de licences d'exploitation de services à grande distance alors que, dans le cas de la téléphonie locale fixe, deux licences étaient octroyées en plus des droits détenus par TdP.
Net2Phone figure parmi les chefs de file mondiaux de la téléphonie par l'Internet sur le marché des utilisateurs finals grand public. Net2Phone Perú est en service dans le pays depuis septembre 1999. Des passerelles ont été installées au Pérou pour l'interconnexion avec le réseau téléphonique public, ce qui permettra de passer et de recevoir des appels téléphoniques via l'Internet.
RCP projette de poursuivre l'extension des centres publics Internet en mettant en place 400 nouveaux centres publics dans le pays. De même, cette société s'apprête à lancer un nouveau projet visant à mettre en place un réseau de plusieurs «monocentres» destinés à assurer l'accès à des services Internet et VoIP intégrés. Un «monocentre» est un centre multimédia ouvert aux utilisateurs de passage et donnant accès à toute la gamme des médias: télévision, radio, Internet et téléphonie. Ce projet prévoit en outre la création d'un grand réseau d'information permettant de faciliter la gestion des problèmes que rencontrent les milieux d'affaires dans les villes, parallèlement à l'appui que constitue la gestion administrative des pouvoirs publics. S'étendant aux 23 départements du pays, le projet sera mis en oeuvre au cours des trois années à venir et nécessitera un investissement de 12 millions USD.
FirstCom, société à capitaux nord-américains et latino-américains (chiliens, principalement), a débuté ses activités commerciales au Pérou en 1999. Elle déploie également ses activités dans d'autres pays d'Amérique latine (Chili, Brésil, Colombie). Début 2000, elle a opéré une fusion stratégique avec AT&T, créant AT&T Latin America. La société a investi quelque 70 millions USD à ce jour dans le réseau à fibres optiques et dans des équipements de soutien pour le réseau.
Après TdP, BellSouth Perú, SA est le deuxième opérateur de services mobiles du pays. Après avoir obtenu des licences d'exploitation de services à grande distance et locaux en 1999, cette société offre aujourd'hui des services dédiés, le service téléphonique public et la téléphonie cellulaire. BellSouth a acquis la plupart des actions du câblo-opérateur Tele2000, mais s'est retiré du service de télévision par câble de ce dernier, commercialisé sous le nom de TeleCable, tout en conservant le réseau en câbles coaxiaux qui couvre toute la ville de Lima. Ce réseau étendu devrait lui permettre de fournir l'accès à l'Internet ainsi que des services de téléphonie, de transmission de données et autres.

Le premier différend concernant la fourniture de services VoIP au Pérou s'est produit en 1999 à la suite d'une action en justice intentée par TdP contre RCP. En mars 1999, TdP a engagé des poursuites contre RCP pour présomption d'«actes de concurrence déloyale». Selon TdP, RCP fournissait un service national et international à grande distance, pour lequel elle ne détenait pas de licence d'exploitation, en utilisant un équipement dit APLIO — petit ordinateur expressément conçu pour les transmissions vocales via l'Internet (voir l'encadré).
Bien que nécessitant l'un et l'autre une ligne téléphonique et une connexion active à l'Internet, les correspondants appelant et appelé n'ont pas besoin d'un ordinateur. L'équipement APLIO permet à l'appelant d'utiliser un téléphone ordinaire. Comment ce système fonctionne-t-il? On branche le téléphone dans le dispositif APLIO, qui est lui-même branché dans une prise téléphonique standard. Tout abonné au téléphone disposant également d'un accès à l'Internet peut ainsi établir des communications à grande distance et internationales via la téléphonie IP. A la date à laquelle le recours a été engagé, RCP était seulement autorisée à fournir des services à valeur ajoutée, dont l'accès à l'Internet. Elle n'était pas dûment habilitée à fournir des services téléphoniques à grande distance ou internationaux.
TdP estimait que le fait de fournir le service national et international à grande distance au moyen de l'équipement APLIO sans détenir de licence conférait à RCP un avantage concurrentiel illicite par rapport aux sociétés dûment autorisées à fournir ce service.
Deux choses étaient certaines. Premièrement, il fallait une licence pour offrir le service à grande distance. Deuxièmement, à l'époque où l'action en justice a été intentée, RCP détenait uniquement une licence pour la fourniture de services à valeur ajoutée, dont le service Internet.
Plusieurs mois après l'introduction du recours, l'organisme de surveillance des investissements privés dans le secteur des télécommunications (OSIPTEL — Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) a rendu un jugement selon lequel aucune licence n'était nécessaire pour commercialiser le dispositif APLIO et RCP, à l'instar des autres organismes commercialisant ce même équipement, n'enfreignait en rien ce faisant les dispositions ou les conditions d'éventuelles licences existantes, la commercialisation de l'équipement ne pouvant pas, par ailleurs, être assimilée à la fourniture du service téléphonique à grande distance. TdP a fait appel de ce jugement. Toutefois, à peu près au même moment, RCP a reçu sa licence pour la fourniture de services à grande distance. Avant que le jugement en deuxième instance ne soit rendu (confirmant le jugement en première instance, reconnaissant le bien-fondé de l'accusation portée par TdP), TdP a renoncé à son recours.
A l'époque, la téléphonie IP faisait l'objet de discussions animées au sein de diverses instances extérieures aux milieux des télécommunications. Un jugement d'un organisme public, en l'occurrence l'OSIPTEL, était nécessaire en raison des commentaires de toutes sortes que suscitait ce nouveau service pourtant encore peu connu du grand public. D'aucuns soulignaient les tarifs intéressants de ce service pour les utilisateurs, qui disposeront à présent d'une option bien meilleur marché que la téléphonie à grande distance classique. D'autres ont examiné la question de la qualité de transmission de la voix ainsi que la possibilité de remplacer ce mode de transmission par la téléphonie commutée. D'autres encore ont pris à tâche de s'interroger sur le caractère licite ou illicite de l'offre d'un tel service au Pérou. Le jugement rendu par l'OSIPTEL dans l'affaire de l'équipement APLIO a donné un premier aperçu des orientations que les pouvoirs publics pourraient adopter dans le domaine de la téléphonie IP à l'avenir.
Les tarifs des communications internationales à grande distance entre le Pérou et les Etats-Unis sont déterminés selon deux méthodes: de PC à téléphone et de téléphone à téléphone. Dans le premier cas, le tarif par minute pour une communication du Pérou aux Etats-Unis est de 0,15 USD via Net2Phone. La même communication via TdP coûte 0,66 USD. Il convient de souligner que la taxe de règlement (qui équivaut à la moitié de la taxe de répartition internationale) que TdP doit payer aux entreprises de télécommunication des Etats-Unis est actuellement de 0,31 USD par minute. Cela signifie que la taxe de règlement que Net2Phone Perú paie à Net2Phone Etats-Unis doit être bien inférieure à celle que paye TdP, c'est-à-dire probablement légèrement en dessous du tarif maximal. Un appel des Etats-Unis à destination de Lima coûte 0,21 USD par minute et 0,30 USD pour les autre villes.
Il est intéressant de noter qu'aux tarifs pratiqués par Net2Phone, il est plus économique d'appeler les Etats-Unis
depuis le Pérou que d'appeler le Pérou depuis les Etats-Unis, ce qui n'est pas le cas si l'on applique les tarifs téléphoniques
internationaux classiques. Jusqu'à présent, les tarifs appliqués dans le sens Etats-Unis vers le Pérou ont toujours
été inférieurs aux tarifs pratiqués dans le sens inverse. La méthode de téléphone à téléphone de Net2Phone
n'est utilisable que pour des appels des Etats-Unis vers le Pérou et les tarifs sont de 50 à 60% supérieurs aux
tarifs pratiqués pour la méthode d'ordinateur à téléphone.
Equipement APLIO: une innovation techniqueL'équipement APLIO est un nouveau type d'équipement doté d'un logiciel et d'un modem de communication vocale via l'Internet. Il comporte un processeur de signaux numériques assurant, entre autres opérations, la compression et la décompression des signaux vocaux conformément à la Recommandation UIT-T G.723.1 à 5,3 et 6,3 kbit/s. L'équipement APLIO a été mis sur le marché au Pérou au prix de 295 USD pièce, avec possibilité de rabais pour achat en grande quantité. Comme dans le cas de la communication vocale au moyen d'un PC, l'utilisateur doit avoir une ligne téléphonique et un compte d'accès à l'Internet, que pourra lui attribuer n'importe quel fournisseur de services Internet. L'équipement APLIO établit la connexion ainsi que la communication avec le fournisseur de services Internet et envoie les adresses IP des éléments qui seront communiqués à ce qu'il est convenu d'appeler le «centre de gestion planétaire» pour établir la liaison à l'Internet. |
La législation péruvienne sur les télécommunications ne s'applique pas expressément au service Internet. A l'époque où l'étude a été réalisée, le ministère des Transports et des Communications a considéré le service Internet comme étant un service à valeur ajoutée. Un tel service se caractérise par l'adjonction d'une fonction ou d'un service complémentaire au service de base (services de télécommunication ou finals). Le classement de l'Internet dans la catégorie des services à valeur ajoutée s'explique, semble-t-il, par le fait qu'il utilise des services de télécommunication et finals (lignes et circuits téléphoniques), ce qui lui ajoute une fonction supplémentaire (la connectivité IP).
Comme indiqué expressément dans la loi sur les télécommunications, tous les services à valeur ajoutée relèvent d'un régime de libre concurrence, ce qui signifie que l'OSIPTEL ne peut pas, en principe, fixer les tarifs de ces services.
La dénomination exacte utilisée par nombre de fournisseurs de services Internet pour désigner le service qu'ils assurent est celle de «service de transmission de données à commutation par paquets». La législation a pour particularité d'exclure le trafic vocal en temps réel de la catégorie des services à valeur ajoutée. Apparemment, à l'époque où cette catégorie a été établie, on savait déjà que les entreprises de services à valeur ajoutée seraient susceptibles d'écouler du trafic vocal mais que, pour écouler un tel trafic en temps réel, elles auraient besoin d'une licence. C'est pourquoi les délibérations sur le sujet de la transmission VoIP ont porté essentiellement sur la question de savoir si cette transmission devait être effectuée en temps réel ou non. Malheureusement, la législation ne donne pas une définition satisfaisante de ce que l'on entend par «en temps réel», ce qui donne lieu à des avis divers sur la question.
Le jugement prononcé dans l'affaire de l'équipement APLIO a été le premier et, à l'époque de l'étude, le seul qui ait été officiellement rendu par un organisme public péruvien sur la question de la transmission de la voix via l'Internet. Tout en se bornant simplement à trancher la question de savoir si la commercialisation d'APLIO constituait ipso facto une fourniture de services à grande distance, ce jugement a levé certains doutes à ce sujet.
L'impossibilité de savoir a priori quel organisme serait compétent pour trancher le différend (le ministère ou l'OSIPTEL) ajoutait à la complexité de l'affaire. Trois positions différentes se sont fait jour au cours de ce débat. Pour certains, le fait que la législation péruvienne ne mentionnait pas la transmission VoIP signifiait qu'il n'existait aucune réglementation sur la question. Par conséquent, ces services pouvaient être offerts en toute liberté. D'autres faisaient valoir que le service VoIP supposait uniquement la transmission de données et non celle de la voix. De ce fait, on ne pouvait l'assimiler à de la téléphonie et il suffisait donc, pour offrir ce service, d'avoir une autorisation de fournir des services à valeur ajoutée. D'autres encore estimaient que le service VoIP équivalait à de la téléphonie et qu'il existait déjà une réglementation applicable en la matière. Dans ce dernier cas de figure, il serait nécessaire d'avoir une licence publique pour offrir ce service.
La tendance au niveau mondial est à la réglementation uniforme des services, quelle que soit la technologie utilisée pour les assurer. Si l'on appliquait ce principe au cas du Pérou, il faudrait déterminer si le service VoIP constitue un service téléphonique, un service à valeur ajoutée ou un autre service, pour être à même de déterminer le degré de réglementation approprié.
Le développement de la téléphonie IP au Pérou est susceptible à l'avenir de demeurer étroitement lié à la puissance commerciale du principal opérateur de télécommunication du pays, TdP. Par conséquent, ce sont les aspects réglementaires (mesures antitrust), plus que les aspects techniques ou commerciaux, qui continueront de déterminer les objectifs de développement de la téléphonie IP dans le pays. La situation que connaît le Pérou n'est cependant pas unique: plusieurs pays de par le monde s'engagent lentement et avec prudence sur la voie du progrès en s'efforçant d'éviter de commettre de graves bévues dans la mise en oeuvre d'une technologie porteuse de grands espoirs, mais également à l'origine de graves problèmes.